
Voilà bientôt six mois que j’ai rejoint une paroisse protestante urbaine, moi qui de toujours ai pratiqué dans les églises catholiques rurales de mon lieu de vie, en conformité avec mon baptême.
Il y a un an, j’affirmais encore ma fidélité paroissiale contre vents et marées, et ce malgré une réelle souffrance tant dans la structure de proximité que dans l’Eglise catholique romaine au sens large. Mais je disais déjà de manière récurrente à mes enfants et amis : “Un jour, je finirai par rejoindre les protestants.” Ce qui, à la fois, me tentait et m’effrayait un peu.
Foncièrement, je ne suis pas une personne versatile qui change de foi “à tout vent de doctrine” (Ephésiens 4, 14). Au contraire, plongée dans l’eau du baptême par mon oncle prêtre et toute une famille fermement croyante dès ma deuxième semaine de vie, il y a bientôt soixante ans, je vivais en cohérence cette appartenance exclusive et de très longue date de toute ma lignée familiale à l’Eglise catholique. Chez moi, on allait à la messe, et on tentait en outre de vivre en cohérence avec les préceptes de l’Evangile, dans la modestie d’une vie rurale et peu prospère.
J’ai déjà évoqué ici les raisons qui m’ont conduite à franchir le pas (voir liens ci-dessous).
Au bout de six mois, je ne peux que constater que mes dilemmes intérieurs se sont considérablement apaisés. Ma pratique n’est plus une obligation et parfois une corvée, quand m’assaillait la pensée de devoir m’agacer à l’homélie et m’ennuyer en deuxième partie de messe de l’immuable rituel. Je me réjouissais d’être lectrice dans ma paroisse, mais ce service m’obligeait à ne manquer aucune messe dominicale, une absence inévitable me contraignant à prévenir et à organiser une suppléance. Ainsi, même les samedis soirs où presque aucun fidèle ne venait, j’étais là, prenant mon mal en patience dans cette église quasi vide qui ne respirait aucun enthousiasme.
Voilà donc déjà un premier point dont je suis délivrée. Je parcours désormais une trentaine de kilomètres en voiture pour me rendre au culte dominical, avec envie mais sans contrainte. Et si je reçois des amis ou s’il vente et tempête, eh bien, je reste chez moi sans sentiment de culpabilité. Je sais que je n’essuierai pas le dimanche suivant des reproches acerbes pour cette absence occasionnelle. Et que pour autant, je retrouverai avec joie mes nouveaux co-paroissiens de culte.
Je me rends ainsi compte désormais que le catholicisme n’est pas qu’une question de foi et de pratique, mais aussi un fort système de pensée dont on n’arrive à se libérer qu’en s’en dégageant peu à peu. Et c’est bien ce que j’éprouve au fil des mois. Un sorte de libération de ma conscience. Penser sur un autre mode.
Oh, cela fait bien des années que je me définis comme “chrétienne” et non comme catholique avant tout ! Je n’ai jamais pu épouser toutes les prises de position magistérielles, et plus le temps passait, plus j’étais en délicatesse avec maintes doctrines catholiques. Mais avec un sentiment latent de culpabilité, de non-conformité, de menace d’excommunication un beau jour à force d’exprimer publiquement des objections au magistère. Il fallait penser comme ci et pas comme ça.
En 2013 déjà, avec toute cette querelle mariage pour tous / manif pour tous, j’étais extrêmement mal à l’aise en tant que catholique sans opinion arrêtée sur le sujet. J’avais ce sentiment pesant de devoir toujours me justifier en tant que pratiquante régulière : non, je ne participerais pas à une “manif pour tous”. Tout comme je n’avais jamais glorifié le fait de faire cinq ou six enfants, voire plus, parce que la contraception était péché. De même, je n’ai jamais porté de jugement péremptoire sur des jeunes et des moins jeunes tentant la vie commune sans mariage ou faisant choix d’un mariage civil ou d’un PACS. Et encore, je n’ai jamais été capable de jeter la pierre à une femme ayant avorté, je n’avais que trop recueilli de confidences désespérées de se retrouver enceinte ou d’avoir subi une IVG douloureuse dans tous les sens du terme. De quel droit, moi, allais-je m’immiscer dans la vie intime d’un couple, dans la conscience troublée d’une femme ne désirant pas, à ce moment-là de son histoire, devenir mère, avec tout le lot d’obligations fortes que la maternité entraîne pour une vie entière ?
Ce ne sont donc pas tant les questions sociétales qui m’ont amenée à prendre du recul par rapport à la pensée catholique : j’ai toujours eu du mal, depuis Jean-Paul II dans ma jeunesse, à accepter les discours péremptoires et injonctifs de ces messieurs en soutane qui de leur vie n’ont jamais eu à appréhender la condition de femme, à vivre dans un corps de femme ou dans un couple au long cours, à se lever la nuit pour un nourrisson ou un enfant malade et à connaître la précarité angoissante quand on a, seule parfois, la responsabilité d’une famille à nourrir.
Mais au-delà des grands poncifs moraux catholiques, il y a plus insidieux encore : une forme de pensée unique là aussi qui anesthésie petit à petit le jugement. Ainsi par exemple, il faut aimer le pape, il faut écouter le pape, il faut lire le pape, il faut citer le pape, il faut obéir au pape et il faut faire preuve d’humilité en se soumettant au pape. Et si ce n’est pas au pape directement, alors à son évêque ou à son curé.
Humilité, vraiment ? N’y a-t-il pas quantité de catholiques conservateurs qui pensent débiter la vérité absolue parce que “Saint Jean-Paul II a dit ou écrit que…” ? N’y a-t-il pas quantité de catholiques opportunistes qui se gargarisent de la moindre phrase du pape François comme s’il était pour eux le Christ sur terre ? Et si nous prenons la liberté, en tant que baptisés éclairés, de contester tel ou tel point de doctrine ou d’encyclique, ne serons-nous pas ramenés manu militari au sacro-saint catéchisme ou de manière ultime au dogme de l’infaillibilité pontificale ? Humilité, ce dogme-là ?
Je redécouvre depuis six mois qu’il est possible d’avoir un esprit et un cerveau qui pensent hors des filtres catholiques tenaces. Au fil des prédications de nos pasteurs, je goûte de nouvelles interprétations des Ecritures, de nouveaux textes proposés à notre méditation, j’éprouve qu’il n’est pas interdit d’avoir un avis sur tel ou tel point de doctrine, qu’elle soit catholique ou protestante, même si cet avis diverge de la majorité “autorisée”. Je respire hors d’un carcan auto-référentiel, je ne fonde plus tous mes espoirs de changement ecclésial sur un synode ou une possible réforme.
Je n’ai pas pour autant quitté un système de pensée pour en adopter un autre. D’ailleurs, en six mois, personne ne m’a demandé si j’avais le désir de me former à la théologie protestante pour être admise au culte ou au service paroissial, personne n’a osé scruter ma vie privée avant de m’inviter à la Sainte Cène.
Ne m’est proposée que la question intérieure fondamentale : est-ce que je reconnais le Christ Jésus comme mon Seigneur et Sauveur ?
A cette question, ma réponse est indubitablement un OUI franc et massif.
Et tout le reste ne m’apparaît plus que comme appartenance, ou non, à un système religieux tissé d’injonctions à croire et à faire ceci et pas cela.
https://www.histoiredunefoi.fr/blog/15254-messe-ou-culte-protestant-mon-experience-et-mon-ressenti
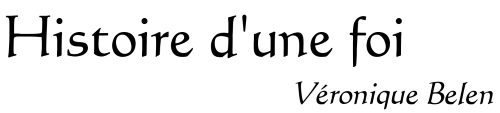










9 commentaires
“C’est vers les fidèles catholiques que le saint Concile tourne en premier lieu sa pensée. Appuyé sur la Sainte Écriture et sur la Tradition, il enseigne que cette Église en marche sur la terre est nécessaire au salut. Seul, en effet, le Christ est médiateur et voie de salut : or, il nous devient présent en son Corps qui est l’Église ; et en nous enseignant expressément la nécessité de la foi et du baptême (cf. Mc 16, 16 ; Jn 3, 5), c’est la nécessité de l’Église elle-même, dans laquelle les hommes entrent par la porte du baptême, qu’il nous a confirmée en même temps. C’est pourquoi ceux qui refuseraient soit d’entrer dans l’Église catholique, soit d’y persévérer, alors qu’ils la sauraient fondée de Dieu par Jésus Christ comme nécessaire, ceux-là ne pourraient pas être sauvés.”
Lumen gentium, vatican 2
Êtes vous sur de votre choix ?
Eh bien Damien, j’irai donc griller en enfer, que vous importe à vous qui êtes si observant et fidèle au Magistère ? J’aurai la monnaie de ma pièce, non ?
Moi j’aimerais vous poser une autre question : quel âge avez-vous, pour oser vous positionner ainsi en justicier du Ciel et de l’Eglise ?
Un repentir ultime est toujours possible, je ne dis donc pas cela.
Mais.
C’est la différence entre un baptisé protestant qui donne son avis totalement subjectif sur la religion, formant l’un des milliers de courants protestants relativiste, et moi : ce n’est pas moi qui donne mon avis c’est le Magistère de l’Eglise Catholique, qui est le même depuis 2000 ans, et qui remonte aussi loin que possible, d’après tout les textes que nous avons, au successeur de St Pierre à Rome.
Est ce qu’à un seul moment les Epitres de St Pierre vous ont laissé pensé qu’on été “libre en Christ” et qu’il n’y avait pas une règle dogmatique et morale à suivre ?
Ou dans ceux de St jacques ? Ou de St Pierre ?
D’ailleurs c’est la même Eglise dont vous vous détournez qui a fixé les 4 Evangiles et le canon biblique, rebooté en partie par les protestants au 16eme siècle (au nom de quelle autorité Luther ou d’autres ses sont ils permis ça ? On se le demande…)
Si le Catholicisme est faux il est probable que le christianisme en entier soit faux…
Votre problème semble être que vous n’acceptez pas la non tolérance sur les questions LBGT ou relativistes de l’Eglise, malgrés qu’elle se montre très charitable à leur sujet. Mais véronique a quel moment les Prophètes et le Christ étaient ils tolérants face au mal ? Il disait quoi St Paul sur les gens LBGT deja ? “Sola sciptura” ?
“Voilà pourquoi, à cause des convoitises de leurs cœurs, Dieu les a livrés à l’impureté, de sorte qu’ils déshonorent eux-mêmes leur corps. Ils ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge ; ils ont vénéré la création et lui ont rendu un culte plutôt qu’à son Créateur, lui qui est béni éternellement. Amen.
C’est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Chez eux, les femmes ont échangé les rapports naturels pour des rapports contre nature.
De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec les femmes pour brûler de désir les uns pour les autres ; les hommes font avec les hommes des choses infâmes, et ils reçoivent en retour dans leur propre personne le salaire dû à leur égarement.
Et comme ils n’ont pas jugé bon de garder la vraie connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une façon de penser dépourvue de jugement. Ils font ce qui est inconvenant ; ils sont remplis de toutes sortes d’injustice, de perversité, de soif de posséder, de méchanceté, ne respirant que jalousie, meurtre, rivalité, ruse, dépravation ; ils sont détracteurs, médisants, ennemis de Dieu, insolents, orgueilleux, fanfarons, ingénieux à faire le mal, révoltés contre leurs parents ; ils sont sans intelligence, sans loyauté, sans affection, sans pitié. Ils savent bien que, d’après le juste décret de Dieu, ceux qui font de telles choses méritent la mort ; et eux, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font….”
je rappel au passage que les Epitres de St Paul précéde les Evangiles, historiquement, mais passons.
Certes le Christ amène, l’importante notion du pardon… mais pour le pardon encore faut il se repentir ! Si ces gens la ne demandent pas pardon à Dieu, ne serait ce qu’au dernier moment de leur vie, comment voulez vous que Dieu les pardonne en retour ? Il ne va pas les forcer à vivre selon ses critères ! C’est le libre arbitre… Le même qui a fait désobéir Adam et Eve.
“Ne m’est proposée que la question intérieure fondamentale : est-ce que je reconnais le Christ Jésus comme mon Seigneur et Sauveur ?”
Mais c’est très bien, seulement, il me semble, que les Ecritures sont assez clairs sur le fait que croire au Christ n’est pas suffisant pour être sauvé… Ni croire en Dieu.
“Ce n’est pas en disant Seigneur Seigneur que vous entrerez au royaume des cieux : mais en suivant la volonté de mon Père qui est aux Cieux”
Et donc pour ça l’Eglise Catholique propose évidemment le chemin qui lui fut légué par les apôtres concernant cette volonté et comment la mettre en pratique. Et avec 2000 ans de miracles à son compteur peut on dire que Dieu y semble opposé ???
Je publie votre commentaire haineux uniquement parce que je le fais toujours. Mais il transpire tellement le dogmatisme aveugle qu’il m’insupporte.
Quant à la question de votre âge, vous n’y répondez pas. Etes-vous une vieille dame effarouchée, ou un jeune blanc bec n’assumant pas son insolence ?
J’ai la quarantaine mais je ne vois pas le rapport.
La Bible est donc rempli de commentaires haineux ???
Je ne fais que la citer…
Êtes vous chrétienne ?
Ou juste fan du Christ ?
Le dogmatisme ? Les enseignements du Christ ? A votre avis ? Il a laissé des enseignements ou non ? A qui ? Son Eglise. Donc maintenant que fait on ?
Bonjour,
Je découvre votre blog très intéressant et qui m’interpelle.
Je suis catholique et ai pourtant lu mains ouvrages écrits par des protestants.
Je pense que la diversité est une richesse.
Peu importe le prêtre ou le pasteur, je ne serai jamais intégralement d’accord avec eux.
Dans ma paroisse, j’ai vu se succéder des prêtres. Aucun n’était parfait. Les paroissiens non plus.
De la même manière, je ne serai jamais à l’aise dans une paroisse réac (protestante ou catholique). Dans ce cas, on peut changer de paroisse. Mais on peut aussi se rappeler que les premiers disciples de Jésus n’étaient pas des pharisiens ! L’Église est ainsi faite.
L’Église, c’est nous qui la formons, avec notre diversité et aussi avec nos défauts.
Et je ne parle pas seulement des autres, ceux qui pensent mal, qui sont hypocrites,…
Comment pourrais-je leur jeter la pierre ? Comment prétendre ôter la paille qui leur trouble la vue ?
À nous d’être le levain dans la pâte, peu importe la paroisse (voire même sans paroisse).
Et même si le levain n’est pas trop efficace, ce qui compte pour moi, c’est d’être en chemin et de savoir que d’autres sont aussi en chemin.
Peut-être que certains se sont arrêtés en cours de route, mais qui suis-je pour les juger ?
Bonne continuation sur votre chemin. Ne perdez pas l’objectif de vue : il ne s’agit pas des rituels, du pape ou du pasteur. Eux sont normalement là pour nous aider à avancer. Si le sermon du prêtre ne me plaît pas, peut-être a-t-il fait avancer mon voisin ?
Nous faisons route ensemble et cela me fait plaisir.
La paix.
Bonjour Véronique. Je vous rejoins sur bien des points et c’est un régal de vous lire. Que la catholicité soit un système féodal voire même totalitaire n’est plus un secret pour personne. Ceux que cela révolte finissent par faire un chemin comparable au vôtre, ou bien arrêtent toute pratique religieuse. Ce qui s’en accommodent, ou bien, pire encore, que ce fonctionnement contente tout à fait restent dans l’Église catholique. Chacun son choix, mais, comme le dit le Christ : QUE TON OUI SOIT OUI, ET QUE TON NON SOIT NON… Y aurait-il une sorte de vertu d’obéissance, implicitement, dans le catholicisme, qui valoriserait une docilité inaltérable face aux errements de nos clercs ? Faudrait-il implicitement souscrire à une soumission de la pensée, des paroles et des actes aux injustices et anomalies internes, présentées comme inévitables. C’est vrai que dans un système totalitaire, les dirigeants ne rendent jamais de comptes à qui que ce soit. Sauf que nous sommes au XXIième siècle, et que la protection du fors interne, le droit d’avoir son opinion, de débattre, et de protester sont des droits quasi-sacrés maintenant. Sauf que l’Église catholique est encore largement imperméable à ce genre de concept. Le bilan déroutant du synode de la synodalité le montre : amener des gens différents à se parler et à accepter des opinions opposées a été présenté comme une victoire ! Cela en est une, certainement, mais à côté de cela, pas d’avancées sur le diaconat des femmes et l’ordination de prêtres mariés. Au programme de l’année à venir ? Se hâter avec lenteur dans des études théologiques “d’approfondissement” des sujets qui fâchent. Le pape François a-t-il autant de pouvoir que cela ? Mais la catholicité est-elle encore réformable ? Vous avez raison, les réformés n’ont pas raison sur tout, mais, comme leur nom l’indique, il y a 4 siècles, ils ont su oser réformer l’Église pour sauver le message du Christ. Larguer l’accessoire pour glorifier l’essentiel. Cela n’a pas rempli les temples, mais au moins, ceux qui s’y rendent trouvent-ils la paix de l’âme, et c’est tout ce que je vous souhaite, du fond du cœur, d’ailleurs. Sans exclure de vous y rejoindre un jour…
Ah parce que le dogme et la morale sont à géométrie variable ?
Dieu est il réformable ? Sa Parole doit se soumettre au lubies et au caprices des Hommes maintenant ?
On a a effectivement pas lu la même Bible…
Y aurait-il une sorte de vertu d’obéissance, implicitement, dans le catholicisme, qui valoriserait une docilité inaltérable face aux errements de nos clercs ?
C’est envers le dogme et la morale catholique qu’il faut obéissance, car elle transmet fidèlement le dépôt de la foi : même si 90 pourcent des clercs se comportaient mal ça ne changerait absolument rien à cela. Le fait que des clercs debordent, soit par conservatisme, soit par progressisme, n’y change absolument rien.
Cela n’a pas rempli les temples, mais au moins, ceux qui s’y rendent trouvent-ils la paix de l’âme, et c’est tout ce que je vous souhaite, du fond du cœur, d’ailleurs
Ou de quoi valider leurs péchés ?
Est ce que vous lisez bien ce qu’ont demandés les prophetes à leur peuple ? Ils leur proposaient la paix de l’ame et le confort d’un culte tranquille ou au contraire le exhortait à ne pas se conformer au monde ? Parce que la morale sous l’empire romain était aussi permissible que maintenant, alors pourquoi s’incarner et vouloir changer ça ??
Avez vous lu les dogmes et doctrines des premiers Pères apostoloques, disciples des apotres ? Oui non ?
Merci Véronique pour votre témoignage…
Je reste dans l’église catholique au sein du Mouvement œcuménique Fondacio et grâce à ce mouvement, depuis trente ans j’expérimente le chemin de la libre pensée… j’ai beaucoup côtoyé d’autres confessions y compris les frères protestants. Pendant vingt ans j’ai accompagné un partenariat missionnaire avec La Fondation protestante La Cause et travers celui-ci j’ai été témoin d’énormes richesses comme bien de limites. Mais je peux comprendre que si votre foi catholique vécue jeune puis adulte était comme un carcan, vous ayez quitter. J’habite dans les Yvelines et si vous êtes où venez en île de France, je serais ravi d’échanger avec vous. Bien fraternellement, Vincent