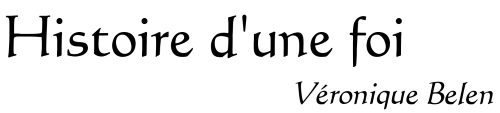XXe siècle, années 60
Dans ces années-là se profile en occident une révolution : l’apparition de la pilule contraceptive.
Mais pas pour cette femme-là, mariée et mère au foyer. : elle est catholique, de milieu très humble et rural.
A ce titre, elle avait été prévenue dans la candeur de sa jeunesse : un mariage consommé équivaudrait à autant de grossesses que sa fertilité le permettrait. Et son frère, pourtant plus jeune qu’elle, ne se priverait pas de la sermonner dès ses années de séminaire : “Il est écrit : femme, tu accoucheras dans la douleur !” car tout de même, toute femme descend d’Eve, l’instigatrice de tout péché, et il faut bien payer l’addition de cette faute impardonnable et source de tant de maux un jour !
Et donc, la logique de la doctrine du péché originel la condamnerait à endurer le pire.
Pure justice au yeux du clergé, composé uniquement de “saints prêtres”, dont il n’était au grand jamais question de remettre la vertu supérieure en question. Au sujet de cette jeune femme, inutile de prendre en compte sa foi entière, sa piété, son humilité insurpassable, son dévouement à toutes les tâches les plus ingrates – c’était avant l’électro-ménager, commençant à apparaître dans ces années-là, mais inaccessible à leur trop maigre budget – et sa fidélité absolue à son mari et même à sa famille maltraitante. Femme elle était, et toute femme avait à expier, en sa chair réputée faible et exposée à la tentation du Malin, le péché des origines, dont ces pauvres hommes étaient les innocentes victimes.
Tout prêtre catholique était alors là pour rappeler à toute fidèle féminine, dans cette Eglise Sainte et Immaculée, sa tragique destinée : expiation et soumission au mari et au curé, le salut ne pouvant se trouver pour elle que dans la maternité, accueillie avec abnégation, et interdiction formelle d’émettre la moindre objection ou plainte.
Et d’ailleurs, le mieux serait toujours qu’elle se taise tout-à-fait en Eglise, et même dans l’absolu, au sujet des choses de Dieu. Le curé à la chaire, le mari en chef de famille, et la femme aux basses besognes que sa condition lui a méritées.
Peut-être aucune femme n’a-t-elle compris mieux qu’elle, dans le martyre de son premier accouchement par le siège, ce que signifiait : “Tu accoucheras dans la douleur.”
Sans oublier la sage-femme religieuse sadique et insultante, ni la mère de la jeune accouchée encore meurtrie et traumatisée pour longtemps, grand-mère surgissant furibonde dans les couloirs de la maternité, en vociférant qu’elle voulait voir le bébé mais surtout pas sa fille, à laquelle elle vouait une incompréhensible haine viscérale depuis toujours.
En matière de récit d’heureux événement, on peut vraiment faire mieux.
Six années passent, saturées pour la jeune maman de grossesses rapprochées, de labeur incessant, de nuits écourtées, de lessives, de cuisine, de vaisselle, d’angoisses pour des toux et des varicelles, d’épuisement physique et moral complet, ponctuées en outre de conflits réguliers et destructeurs avec sa mère et son frère.
C’est dans ce contexte-là qu’elle donne naissance, au cœur d’un hiver enneigé, à une quatrième fille.
C’est la disgrâce. L’enfant de trop. La honte de n’être pas même capable de mettre au monde un garçon !
Voilà une naissance sans aucun faire-part, qui gêne voire indiffère. Tout le monde s’en serait bien passé.
Un bébé dont on aimerait ne pas avoir à faire mention., et d’ailleurs, il n’y avait plus aucun prénom de fille à disposition, dans la réserve de leurs désirs. Vous aurez beau, aussi, fouiller dans les vieilles boîtes à photos noir et blanc, vous n’y trouverez pas trace de ce petit visage indésiré avant ses deux ou trois ans.
Dans les années et les décennies qui suivent, de telles naissances se produiront beaucoup moins.
La pilule, puis l’IVG.
Puis encore l’IVG sélectif, qui élimine, depuis les progrès de l’échographie, surtout les filles, en bien des contrées de tradition toujours patriarcale. On pourrait appeler cela le massacre des saintes innocentes.
Finalement, elle a quand même eu de la chance de naître, cette petite-fille là, même si c’est à revers de tout désir et de tout projet, même si c’est pour toute une enfance et une adolescence de questionnement et de mal-être, avec cette difficulté originelle à trouver sa place dans une famille et dans le monde, quand on se sait en surnombre.
N’importe.
De cette naissance indésirable et indésirée, elle a gardé pour toujours le goût de vivre, mesurant la chance d’être là et bien là, de ne pas avoir été simplement éradiquée, de pouvoir grandir, apprendre à lire et à écrire, de pouvoir chanter, jouer dans les prés et, trésor précieux tout au fond de son cœur, cette allégresse de se sentir dans toute église comme dans sa propre maison. Cette joie aussi, qui surpasse toute ses tristesses et tout son ennui, dans cette vie rurale sans voyages et sans loisirs, cette joie qu’elle éprouve depuis toujours au contact de l’unique frère qui lui ait été donné : Jésus, son ami, son modèle, son espérance, son chemin de vie, son bel et virtuose orateur, son compagnon d’escapades champêtres, son complice de travaux agricoles et son charpentier préféré, dont elle devine les mains agiles et précises en observant son papa dans l’atelier de menuiserie, dans la délicieuse odeur du bois scié, et les mille idées de jeux qui lui viennent avec copeaux et sciure.
C’est peut-être bien là qu’elle se sent le mieux, près de son père tant aimé, toujours au travail, mais capable parfois, pour sa plus grande consolation, de lui lancer un regard et un sourire pleins d’affection, rayon de lumière à travers lequel elle perçoit soudain, dans l’immensité de sa culpabilité d’avoir forcé la porte de la vie, qu’elle est quand même aimée, et peut-être même chérie, par ce papa qui sait deviner en elle des beautés et des richesses intérieures tellement profondément dissimulées dans son cœur pudique.
C’est une famille dans laquelle on n’a ni les mots, ni les gestes de la tendresse, mais chevillés au fond de tous les cœurs et de toutes les volontés, l’honnêteté foncière, le sens du devoir et du travail, la haine du mensonge, et la rage d’émerger des tréfonds de la misère et de l’inculture. On n’a pas d’ancêtres instruits, mais on lit et on apprend. On n’a presque pas de livres, mais on voit la bibliothèque de l’école comme le salut à saisir. On n’a aucun élément de comparaison en matière de religion, mais on vit avec intensité sa fidélité au baptême reçu nourrisson, on va à la messe tous les dimanches, on aime notre curé tellement cohérent entre son dire et son agir, on chante à la chorale, on milite dans les mouvements catholiques ouvriers, on ne dit jamais le chapelet et on ne pratique jamais l’adoration eucharistique, mais l’Evangile, on le connait sur le bout des doigts, on le lit, on le médite, on le cite et on le vit.
Et avec tout ce recul, malgré mes souvenirs d’une enfance de privations et de labeur, je rends grâce pour cette éducation solide, aux valeurs saines et honnêtes, pour l’impulsion de nos parents à réussir à l’école et par l’école, même s’ils étaient bien incapables de nous aider dans nos devoirs. Je rends grâce pour leur foi fidèle et concrète, vécue dans leurs interactions sociales avec sincérité, et pour l’accès tout naturel aux sacrements et aux valeurs de l’Evangile, qui nous étaient plus familiers que l’esprit du monde.
Années 90
La voilà adulte. Elle s’est mariée et elle a trois enfants.
Mais voilà que depuis la naissance de leur deuxième enfant, pourtant une adorable fille tellement désirée, après un délicieux petit garçon premier-né, elle vit un véritable enfer conjugal.
A force d’un gaslighting permanent de la part de son mari, une sorte de Docteur Jekyll et Mister Hyde, charmant et charmeur avec tout le monde, sauf avec elle, c’est le chaos dans sa tête et le supplice continu du harcèlement moral sous son toit.
Au tournant du millénaire, il ne lui laisse plus aucun répit, le mari adulé par toute sa famille, toutes ses amies, tout le village où il plastronne sous son meilleur jour, au point qu’elle se sent, sous son mépris ou au mieux face à son indifférence absolue à elle, la plus mauvaise en tout : nulle comme épouse, nulle comme mère – lui s’étant octroyé le rôle avantageux du papa-copain, joueur et permissif à outrance – et même nulle comme paroissienne, car ils sont de mèche, le mari et le curé, pour la qualifier peu à peu de “folle du logis”.
C’est qu’elle a commis une erreur fatale : au cœur de son désespoir conjugal, Dieu s’est souvenu d’elle, il l’a prise contre son cœur de Père pour la consoler de son immense solitude affective et sociale, il lui a rendu le regard et le sourire d’amour, naguère lancés vers elle par son papa dans l’atelier de menuiserie, il lui a murmuré à l’oreille mille secrets d’amour et de vérité, mille réponses à toutes ses questions de toujours… Il lui a prodigué, dans le secret de sa prière nocturne, tant et tant de grâces indicibles, mais tellement puissantes qu’elle n’a vraiment pas pu les taire. Parce que cette grâce prodigieuse et cet honneur suprême de la confiance de l’Eternel, dont elle se sentait tellement indigne, il fallait qu’elle les partage au monde par le biais de l’Eglise, il le fallait ! C’était bien trop important pour demeurer caché sous le boisseau.
Alors, comme elle était presque seule au monde dans sa foi si intense – amies les plus proches athées voire antichrétiennes – elle a cru son mari légitime à recevoir ses confidences. Elle lui a tout raconté. Et il a fait mine de la croire, et puis choisi de pratiquer désormais son expertise en gaslighting dans ce domaine-là, puisqu’il était sûr de pouvoir l’atteindre ainsi dans les profondeurs de son âme la plus sincère.
Un jour je te crois, un jour je ne te crois pas.
Un jour je te qualifie de prophète, en réfléchissant déjà à la meilleure manière d’exploiter ce filon, un jour je brandis de vieux livres poussiéreux de psychiatrie des années 60, en éructant que tu es en plein délire mystique.
Un jour je te jure de tout faire pour t’aider, car je suis le meilleur médecin au monde, un jour je téléphone aux confrères psychiatres pour comploter de t’interner.
Un jour je fais semblant de te comprendre et de compatir à ta souffrance, un jour je vais déjeuner au restaurant avec la personne la plus toxique avec toi de tout ton entourage, et je complote encore de plus en plus sérieusement de te faire interner, avec la bénédiction de toute ta famille et de tous tes “amis”.
A bout de souffrance sous ce harcèlement continu, dont personne jamais n’est spectateur, sinon nos malheureux enfants – Docteur Jekyll arbore le sourire et des manières mielleuses en société pour faire encore croire à sa perfection, tandis que Mister Hyde a des rictus de haine et les narines fumantes quand il veut, en huis clos, détruire son épouse – elle finit par observer une semaine complète de silence à son endroit, et médite sa fuite de cet enfer.
16 février 2001, 17h, début des vacances scolaires d’hiver
Elle prend ses trois enfants avec elle et elle fugue en voiture. Fuir cet enfer où elle se meurt à petit feu. Fuir les tentations quotidiennes d’en finir une fois pour toutes par le suicide. Fuir.
Mais jamais, jamais sans ses enfants.
C’est pour eux qu’elle garde la force de vivre, c’est avec eux qu’elle nourrit l’espoir de prendre un nouveau départ régénérant, ailleurs.
Mais tout est vraiment très confus dans sa tête.
Elle a subi tellement de manipulation mentale insidieuse ou violente depuis huit années déjà, et à une intensité redoutable ces deux dernières années, qu’elle ne sait plus du tout qui elle est.
Désocialisée pour se consacrer à ses enfants, sans activité professionnelle depuis la naissance de la petite troisième, elle n’a plus aucun statut, aucune valeur sociale.
Jamais, jamais il ne la remercie au quotidien pour le confort patriarcal qu’elle lui offre, jamais un mot aimable, jamais un geste tendre. Du dénigrement permanent, comme si elle était décidément le déchet de l’humanité.
Alors, elle a un but, et elle y croit : aller se réfugier tous les quatre, les trois petits et elle, dans une abbaye bénédictine où elle compte un ami dans la foi, un correspondant occasionnel, un moine âgé mais à la calligraphie éblouissante de régularité, le seul qui, il y a quelques mois, a compris et cru un tant soit peu ce qu’elle vit dans sa prière.
Elle conduit dans la nuit tombante dans cette folle espérance : là, dans une maison de prière, elle retrouvera la paix intérieure, elle aura enfin des interlocuteurs spirituels, qu’elle imagine tous saints, et ses enfants seront enfin à l’abri des éclats de voix, les siens et ceux de leur père, qu’ils n’ont déjà que trop subis.
Elle y croit de toutes ses forces, même si l’heure des complies est déjà passée à l’abbaye. Elle y croit. Echapper à l’enfer, et mettre ses enfants à l’abri. Une impérieuse nécessité, dans cette impasse conjugale et familiale.
Il reste maintenant quelques dizaines de kilomètres à parcourir, et il fait nuit noire.
C’est au demeurant une fugue bien organisée : dans plusieurs valises, il y a tout ce qu’il faut pour elle et ses enfants, pour une durée indéterminée, espérée la plus longue possible. C’est repassé par elle et soigneusement rangé, avec même leurs jouets préférés.
Mais dans l’urgence de cette fuite nécessairement indécelable par son bourreau de mari, elle n’a pas pris le temps de préparer l’itinéraire (on est avant les GPS). La nuit est tombée, elle est stressée car elle se doute bien que son mari, découvrant au soir la maison vide, va envoyer la police à ses trousses.
C’est aussi avant le téléphone portable. Fatiguée, perdue, elle s’arrête à un péage, et dans une cabine téléphonique, elle compose le numéro de l’abbaye pour demander son chemin.
D’abord, le frère portier qui décroche ne veut lui passer absolument personne.
D’une voix pas très agréable, il lui dit avec insistance qu’elle doit être malade.
Et puis après, à force de supplications, quand elle peut enfin parler au moine avec lequel elle correspond, elle apprend par lui que de toute façon, il n’y a pas de place pour eux à l’hôtellerie.
On se couche tôt en abbaye. On reçoit à l’hôtellerie sur réservation. On n’improvise en aucun cas l’hébergement d’une maman en fuite avec ses trois enfants.
Qu’elle veuille bien se trouver un hôtel pour la nuit, avec ses enfants, et qu’elle retourne le lendemain chez son mari.
Il a téléphoné avant elle à l’abbaye, sachant bien qu’elle n’a plus personne au monde à part ce vieux moine.
Il a raconté là, sur elle, tout ce qu’il a voulu, selon son habitude.
Il a même dû pleurnicher qu’il aimait sa femme, selon son habitude. Et le vieux moine catholique, probablement ardent défenseur de l’unité familiale, l’a cru sur parole.
Depuis quand un mari aussi charmant et brisé au téléphone pourrait-il être maltraitant ?
Le plus dur pour elle, cette nuit-là, sera de prendre brutalement conscience qu’elle était depuis des mois en proie à un violent conflit spirituel intérieur, une tentation qui lui a fait croire qu’il y aurait pour elle, quelque part en Eglise catholique, de la bienveillance et de l’accueil inconditionnel.
Vaste chimère.
Une mère de trois enfants se doit coûte que coûte de demeurer auprès de son mari, violences conjugales ou pas.
Et si elle y entend quelque chose aux commandements divins, elle est priée de chérir son mari et ses enfants, de servir sa paroisse en catéchèse ou en soin des linges liturgiques.
Depuis quand Dieu se passerait-il de la médiation des clercs pour inspirer une femme catholique, et lui révéler des mystères auxquels eux-mêmes n’ont pas accès ?
Depuis quand ce bon Docteur Jekyll ne serait-il plus le mieux placé pour savoir ce qui se passe dans l’âme de sa femme, et d’autant plus que son excellente réputation ne saurait laisser affleurer aucun doute quant à sa pertinence médicale et sa moralité familiale irréprochable ?
Il n’y avait pas de place pour eux à l’hôtellerie.
Toute une communauté de moines bénédictins la renvoya vers son mari, adoubé ainsi par l’Eglise, en plus de tous les soutiens qu’il obtenait sans aucun problème contre elle.
19 février 2001, 10h
Hospitalisation sous contrainte, signée par le bon Docteur Jekyll, en pavillon fermé de psychiatrie, et s’il vous plaît, le plus vétuste et le plus surveillé de la vaste structure. Peut-être pourrait-elle s’avérer dangereuse, on ne sait jamais. Dépouillée de tout, dans la promiscuité des fous.
Injections répétées des plus violents neuroleptiques, au pays où règne le psychiatre, comme le plus fin connaisseur des âmes.
Surtout, ne poser aucune question à cette patiente délirante. Docteur Jekyll, ce pauvre homme effondré, leur a déjà raconté toute SA version des faits.
Elle voulait fuir l’enfer conjugal, elle a atterri dans l’enfer carcéral psychiatrique.
Ici aussi, on est enfermés. Mais pas avec le confort dont se plaignait pourtant un dénommé Nicolas Sarkozy : ici, au pavillon 9.2, une salle de bain par service, dans laquelle on se fait enfermer de l’extérieur, et libérer si on tambourine assez longtemps et assez fort à la porte verrouillée.
Et surtout, on ne peut plus ni lire, ni écrire, et à peine manger : on est plongé dans un brouillard intérieur total à force de se faire injecter des poisons.
Tout ça pour redevenir conforme à la norme sociale française, de préférence athée, ça pose moins de problèmes, et en cas de foi chrétienne, on est prié de ne plus jamais oser dire qu’on a rencontré Dieu, ou le Christ, dans sa prière.
En cas de récidive d’oraison consolante, menace mise à exécution d’un nouvel internement.
Et pour se préserver de l’illusion mystique, neuroleptiques à vie.
Docteur Jekyll a parlé, signé et fait interner, et Mister Hyde a gagné.
(Du moins, c’est ce qu’il croit.)
Source image :
https://www.rts.ch/audio-podcast/2023/audio/guichet-la-violence-psychologique-au-sein-du-couple-26171866.html